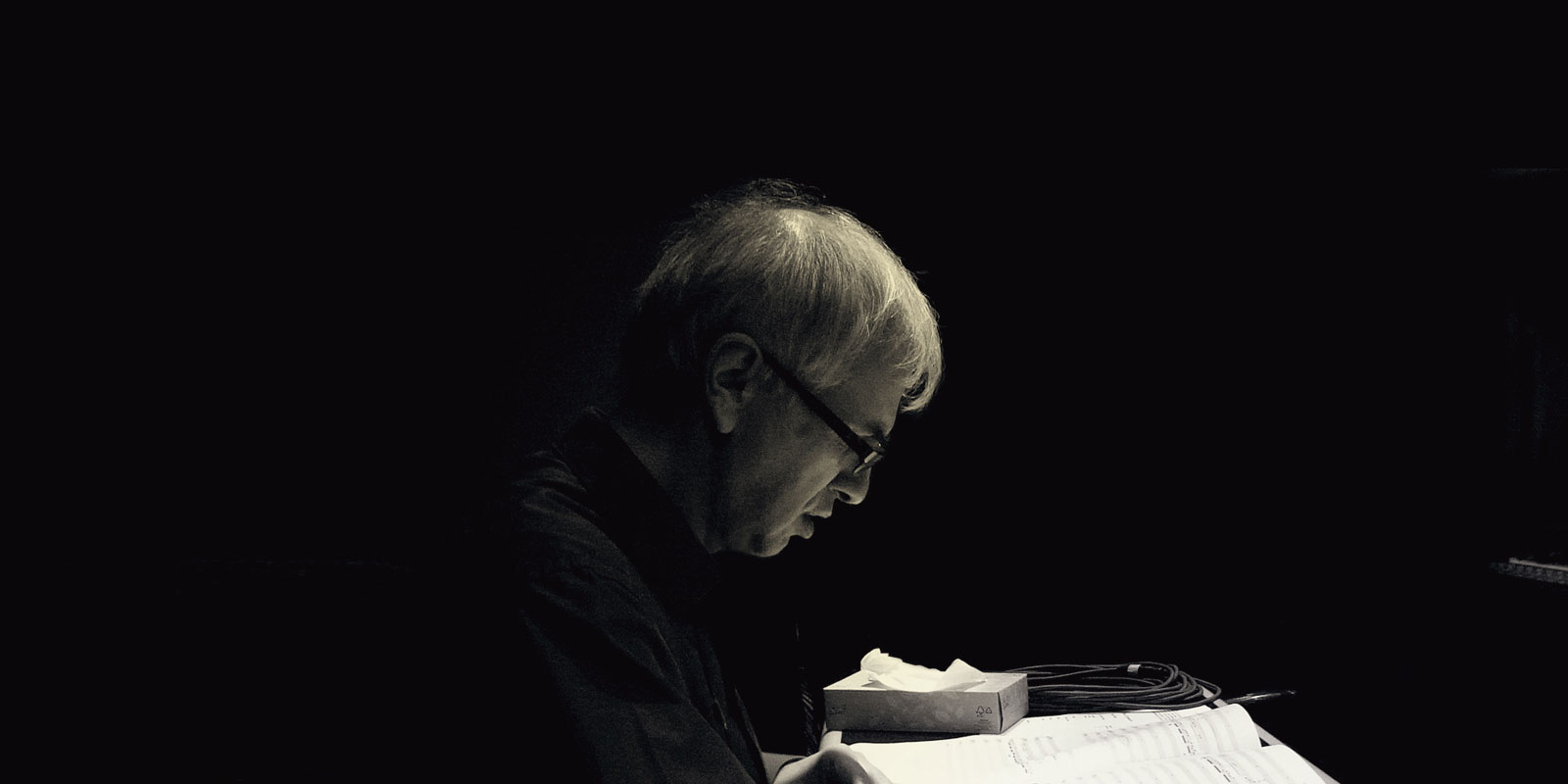Présent à Soeurs Jumelles dans le cadre d’une conversation artistique avec Akhenaton, Bruno Coulais est certainement le compositeur français de musique de films le plus prolifique. Triplement césarisé pour Microcosmos : le Peuple de l’herbe (1997), Himalaya : L’enfance d’un chef (2000) et Les Choristes (2005), il est aussi le compositeur fétiche de Jacques Perrin dont les documentaires Le peuple migrateur et Microcosmos fêtaient respectivement leurs 20 et 25 ans fin 2021. Retour sur une rencontre à Cannes lors du festival 2021.
Comment êtes-vous devenu compositeur de musiques de films ?
Par le plus grand des hasards. Pendant mes études de musique, je faisais un stage à l’auditorium Antegor dans le 16ème à Paris. Un endroit assez extraordinaire où l’on pouvait croiser Orson Welles ou Frédéric Rossif. Et François Reichenbach, un grand documentariste qui a beaucoup fait pour la musique, puisqu’il avait fait un film sur Rubinstein qui avait eu l’oscar, a su que je composais grâce à sa monteuse qui était une amie. Il m’a dit de lui composer quelques musiques pour des documentaires. D’abord un, puis plusieurs. Au départ, ce n’est pas du tout ce qui m’intéressait car j’avais une idée un peu “pure” de la musique. Mais finalement, grâce à lui, je me suis intéressé au cinéma. J’ai hanté les salles du quartier latin et je me suis rendu compte que le cinéma n’était pas seulement un divertissement mais un art. J’ai découvert Bergman ou Buñuel en passant par les grands réalisateurs italiens et américains. Après, de fil en aiguille, j’ai fait des musiques de courts métrages, de télévision et puis de cinéma, et je n’ai plus jamais arrêté.
En quoi la musique d’un documentaire animalier est-elle particulière ?
Dans des films comme Microcosmos ou Le peuple migrateur, il y a très peu de paroles. Donc, la musique a une double fonction : commenter les images et tirer le film vers la fiction. Elle nous plonge dans un monde un peu fantastique, loin de la réalité. En tous cas, c’est ce que j’ai essayé de faire. Je pense que la musique, comme les sons, aident le spectateur à sentir que le film n’est pas seulement un documentaire animalier avec de belles images, mais vraiment un film de cinéma et de fiction. Elle est narrative, et en même temps, d’ambiance. Dans ce genre de films, les sons ont une part primordiale. Mélangés à la musique, ils créent un monde totalement subjectif. Après tout, pourquoi mettre de la musique sur des images d’insectes ou d’oiseaux ? Justement parce que ça aide à faire basculer le film dans un monde inventé, féérique, un peu comme un conte. Pour moi, ce sont d’ailleurs plus des contes animaliers que des documentaires.
Moins de paroles, est-ce plus de liberté ?
Au départ, on se dit qu’on va être libre en n’étant pas embarrassé par les dialogues. Parce que c’est tout un art d’écrire de la musique sous les dialogues, même si c’est passionnant aussi. Après, on se rend compte que finalement, la musique obéit aux mêmes lois que sur des films traditionnels. C’est-à-dire qu’il faut respecter la densité de l’image, la densité orchestrale. Il ne faut pas écraser l’image, il faut la faire vibrer de la même façon. Donc, on n’est pas forcément plus libre, mais on a peut-être plus de place. Un peu comme dans les films d’animation sur lesquels j’aime beaucoup travailler.
Qu’est-ce que cela changeait de se placer à hauteur d’insectes dans Microcosmos ?
L’idée était de montrer que la musique de film n’était pas forcément un genre en soi. Ce n’est pas systématiquement un orchestre : ça peut être des bruits, des bruitages, du bruitisme musical. J’avais beaucoup travaillé avec Philippe Barbeau, l’ingénieur son, sur des bourdonnements réels. J’avais écrit en fonction, avec des quintets à cordes répartis dans l’espace. Et puis, il y a aussi une musique qui ouvre le film, qui est chantée par un enfant. Elle montre au spectateur qu’on n’est pas dans un documentaire, mais qu’on va rentrer dans un monde inconnu, proche de nous, féérique et fantastique.
Et comment avez-vous composé à hauteur d’oiseaux pour Le peuple migrateur ?
À travers la vision subjective des oiseaux en vol, Le peuple migrateur avait une fonction plus écologique. Il y a beaucoup de plans en vol au-dessus de cette terre sublime. Il s’agissait de montrer la beauté de notre planète, mais aussi à quel point elle est menacée : ça passait par l’émotion musicale. Moi, je n’aime pas beaucoup quand la musique double ce que l’on voit à l’image, quand elle essaye de nous prendre par la main. Ici, je pense que son rôle est de faire prendre conscience au spectateur à quel point il faut protéger la terre. Et en même temps, de suggérer l’épuisement des oiseaux qui font des milliers de kilomètres. J’avais fait des rythmiques de battements d’ailes, toujours pour sortir du cadre de la musique de films traditionnels. Mélanger des sons, des battements d’ailes aux voix des chœurs, comme des espèces de respiration, puis orchestrer tout ça.
“La musique devient un personnage autonome qui révèle toute cette part non dite, secrète du film”
Quand vous composez, le faîtes-vous en accord avec l’univers sonore du film ?
Oui car je crois que la beauté de ce métier, c’est d’aller chercher la part secrète dans un film. Et l’univers sonore peut révéler ça. C’est très subjectif : le compositeur va chercher les bruits qui font qu’un film est singulier, pour que la musique devienne un personnage autonome qui révèle toute cette part non dite, secrète du film.
Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Jacques Perrin ?
J’avais travaillé sur la série Médecins des hommes qu’il avait produite pour la télévision, mais c’est surtout sur Microcosmos que la rencontre s’est faite. Et je dois dire que c’est un des personnages qui m’a le plus impressionné dans le monde du cinéma, et pas seulement. C’est quelqu’un qui a un tel charisme, qui met une telle passion dans tout ce qu’il a fait. Il nous montre que le cinéma n’est pas seulement un divertissement, mais un engagement total. Donc travailler avec lui, c’est presque dépasser le cap du cinéma. C’est suivre sa folie, sa quête d’absolu. Et épouser sa volonté de faire le film dont il a rêvé en poussant le plus loin possible l’expérimentation et le travail.
Comment a évolué votre collaboration au fil du temps ?
Depuis toujours, il accorde une place primordiale à la musique. Mais, comme je le connais depuis longtemps, nos procédés de travail sur les films ont énormément évolué. Sur Microcosmos, je lui avais joué le thème au piano avec mon fils pour chanter cette espèce de comptine. Aujourd’hui, nous travaillons grâce à des maquettes très précises qui donnent une idée très claire de ce que sera la musique. Ça nous permet de faire des projections car ces maquettes permettent de voir ce qui marche, et ce qui marche moins bien. C’est un vrai travail : la musique devient comme un matériau de montage. Ensuite, on peut passer à l’enregistrement. Et quand on a réalisé ceux du Peuple migrateur, mais aussi d’Océans, et des Saisons, Jacques n’avait que de bonnes surprises quand on était face à l’orchestre ou aux musiciens.
Considérez-vous le compositeur comme le troisième auteur d’un film ?
C’est vrai qu’il y a un apport créatif de la part du compositeur. Mais il ne faut pas que les compositeurs aient trop d’égo parce qu’ils sont avant tout au service d’un film. Je me suis par exemple posé la question de l’utilité de ce prix de la création sonore à Cannes. Et Jean-Noël Tronc, qui était alors Président de la SACEM, m’a convaincu. Il m’a fait comprendre que cette reconnaissance du troisième auteur était importante, notamment pour les débutants. Et que, peut-être, l’attribution d’un prix à Cannes mettrait plus en lumière le travail et l’importance du compositeur. Je n’y avais pas prêté attention avant, d’autant que je me méfie des prix . Souvent, après en avoir reçu, on croit qu’on sait faire les choses, mais chaque film pose de nouveaux défis sur les rapports de la musique et de l’image.
Propos recueillis à Cannes 2021, par Pierre Lesieur